1914, "Cinquante ans de souvenirs", (3e édition) comte de Maugny, Albert de (1859-1909), avec une préface de M. René Doumic.
Mention Lien:--- Bourré et M. Thiers et L'assassinat du Shah de Perse prédit
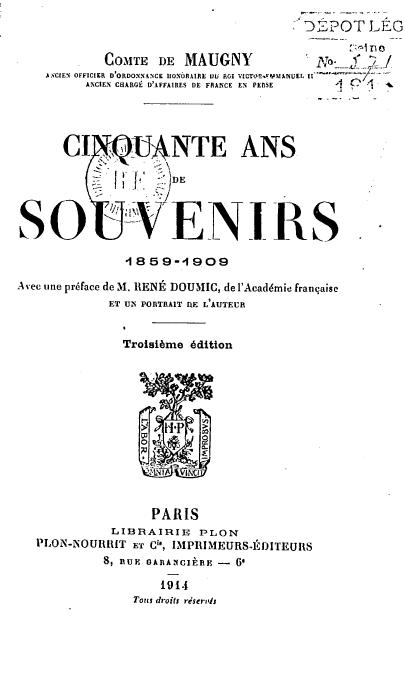

PRÉFACE
Les Mémoires sont aujourd'hui plus à la mode qu'ils ne l'ont jamais été. Cela tient d'abord à la vogue si justifiée qu'ont eue, en ces derniers temps, quelques spécimens particulièrement brillants du genre, et qui ont remis le genre lui-même en honneur : les héroïques Mémoires de Marbot, les piquants Souvenirs de la comtesse de Boigne. Mais j'y vois une autre cause encore et plus profonde : l'accord avec la tendance qui domine actuellement en littérature.
Nous nous méfions, même à l'excès, de tout ce qui est considération générale, abstraction, entité philosophique. Nous avons le goût des faits et même des petits faits. Une anecdote, une scène, un détail intime, un trait de murs ou de caractère nous semblent en dire long sur une époque, pour qui sait en dégager la signification
II CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Nous aimons qu'on vienne nous dire : « J'étais là, cette chose m'advint. » Les Mémoires ont pour nous l'incomparable autorité d'une déposition de témoin.
Encore faut-il que le témoin ait été en mesure de voir, et qu'il soit en possession de nous faire voir ce dont il a été le témoin. Il faut qu'il se soit trouvé dans un poste d'observation favorable, et qu'il ait, avec un tour d'esprit curieux, des qualités de peintre. C'est cette double condition que les Cinquante ans de souvenirs du comte de Maugny réunissent à un degré tout à fait remarquable.
J'y note d'abord un mérite bien rare chez celui qui entreprend de nous conter ses souvenirs : c'est la complète absence de toute vanité, comme de tout souci de se mettre soi-même en scène. Le narrateur est d'une modestie qui est un charme et qui sent son homme du meilleur monde. Il s'efface discrètement. Il concentre toute la lumière sur les milieux qu'il a traversés, sur les figures de premier plan qui s'y détachent en plein relief. On a sous les yeux de brillants tableaux, entre lesquels s'ordonne une existence qui s'est déroulée dans les décors les plus variés.
Cela s'ouvre par une évocation guerrière,
III PREFACE
dans un bruit de victoires. Pour entrée de jeu, le futur mémorialiste a eu ce premier spectacle : la guerre d'Italie. Il y fut non pas seulement témoin, mais acteur. Il était à Montebello, il était à Magenta, avec le jeune lieutenant de
Galliffet Officier d'ordonnance du général de Sonnaz, puis commandant l'escorte du maréchal Baraguey d'Hilliers, il rencontre le duc de Chartres, et il aperçoit Edouard André dans cet uniforme des guides où devait le peindre Mlle Jacquemart. A Solferino, le jeune Maugny fut décoré sur lé champ de bataille. Ce claquement de drapeaux et ces fanfares belliqueuses font une belle introduction à des Mémoires écrits par un Français.
Français, le comte de Maugny l'est devenu par libre choix et parce qu'il l'a voulu. Sa famille était originaire de Savoie. Lors de l'annexion, il choisit d'être des nôtres, ayant déjà le cur et l'esprit français et l'ayant prouvé.
Il quittait un souverain, il allait passer sous les ordres d'un autre : il fallait prendre congé du premier, se présenter au second. La visite à Victor-Emmanuel était délicate : M. de Maugny s'en tira avec cette présence d'esprit et cet esprit
IV CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
d'à-propos qui lui ont rarement fait défaut.
Quant à l'accueil de Napoléon III, il fut ce qu'il devait être : M. de Maugny n'en oublia jamais la bonne grâce. Et ce ne fut pas la seule raison pour laquelle il conserva à l'Empereur des Français, puis à sa détresse, puis à son souvenir, la même loyale et inaltérable fidélité.
Le voilà maintenant mêlé à cette société du second Empire dont il a connu tous les grands premiers rôles, toutes les beautés célèbres.
Nous nous reportons aujourd'hui avec une curiosité passionnée vers cette société; nous sommes avides des récits qui nous la font connaître.
Cela est facile à comprendre. C'est la société qui a précédé immédiatement la noire : elle nous intéresse par le contraste. Elle appartient déjà à l'histoire, mais c'est à une histoire toute récente et qui ne s'est pas encore enfoncée dans un lointain passé. Les liens qui nous rattachent à elle ne sont pas encore brisés. Elle se prolonge parmi nous par les survivants qui témoignent pour elle. Elle est en train de s'évanouir dans des brumes de soleil couchant et nous la suivons d'un long regard, où se mêlent à la curiosité la mélancolie et les regrets. Cette partie des Mémoires de M. de Maugny ne sera
V PRÉFACE
ni la moins lue, ni la moins citée, ni la moins pillée.
En ce temps-là, qui était comme un rappel des temps chevaleresques, on dansait la veille, on se battait le lendemain. Légèreté et bravoure, toute l'époque tient dans ces deux mots.
Après l'Italie, l'Algérie : M. de Maugny fut parmi nos plus vaillants soldats d'Afrique. Il y connut Pélissier et Margueritte, et d'autres dont les noms sont inscrits au livre d'or de l'héroïsme français. Quand il rentra à Paris, c'était le jour des funérailles de Morny. Rencontre qui semble faite à souhait pour un peintre d'histoire; mais on sait que l'histoire naît d'elle-même sous les pas de ceux qui doivent la peindre.
Ici une nouvelle phase dans la carrière de M. de Maugny. L'officier devient diplomate.
Et c'est pour lui l'occasion de nous promener à travers un personnel diplomatique auquel on dit que celui d'aujourd'hui ne ressemble guère. Il est envoyé en Perse, reçu par le shah et profite de l'occasion pour ouvrir tout grands les yeux sur les singularités de ce « pays estrange » d'où les progrès de notre civilisation n'ont pas encore chassé tout pittoresque. Heures amusées qui se changèrent eu heures d'angoisse. La
VI CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
guerre venait d'être déclarée contre l'Allemagne; le représentant de la France avait reçu ordre de ne pas quitter son poste; et c'est là-bas, dans la fièvre de l'éloignement, que lui arrivait l'écho lugubre de nos désastres.
Il revint, au lendemain de la Commune, dans Paris en ruines, fumant encore de l'incendie allumé par la guerre civile. Le cur brisé, il fit un pèlerinage à tout ce qu'il avait respecté, aimé et dont maintenant il portait le deuil. Parmi les
visions que nous aurons sous les yeux dans cette dernière partie des Cinquante ans de souvenirs, il en sera beaucoup de douloureuses. L'ombre s'étend... Mais solidement trempé, aimant la vie, Maugny n'était pas de ceux qui s'enfoncent dans leurs souvenirs, au point de s'y absorber, et que leurs regrets paralysent. Tout en restant attaché au passé, il ne bouda pas le présent. Il approcha les hommes du nouveau régime; il eut sa chaise dans les salons où, quoi qu'en
disent ceux qui n'y vont pas, on continue à causer.
Et il devint journaliste. En France on disait jadis que tout finit par des chansons ; aujourd'hui, tout finit par des articles de journaux.
J'ai tort, puisque, à ces articles nécessairement éphémères, M. de Maugny a su ajouter
VII PRÉFACE
ces Mémoires auxquels recourront souvent les historiens de l'avenir. Ils y chercheront ce qu'on demande toujours aux Mémoires, quels qu'ils soient : des portraits et des scènes Les portraits, dont on trouvera dans ces pages toute une galerie, ont un premier mérite : la sincérité. Que ce soit Victor-Emmanuel ou Napoléon III, Gavour ou Morny, le prince Napoléon ou Gambetta,
M. de Maugny les peint tels qu'il les a vus, sans se soucier si le jugement qu'il en porte contrarie l'opinion généralement admise. Quant aux « scènes », il me suffira de signaler au lecteur un déjeuner, à Gbislehurst, avec l'Impératrice veuve, exilée, déchue, et une dernière entrevue avec le général Boulanger, vaincu, défait, sanglotant.
Tout le tragique des révolutions plane sur ces pages sans apparat.
Et je m'aperçois que j'ai oublié de dire que M. de Maugny est un excellent écrivain. Il est du pays qui nous a donné François de Sales et Vaugelas, Joseph de Maistre et Costa de Beauregard.
Il continue la tradition. Cinquante ans... longue période pour la vie
humaine, aurait dit déjà l'historien antique. Et la vie d'aujourd'hui va beaucoup plus vite que jadis! Les événements se précipitent. Les changements
VIII CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
sont rapides et brusques. En se regardant soi-même dans le passé, on ne se reconnaît plus. Si peu que M. de Maugny soit un esprit chagrin, la comparaison qu'il fait du monde où il a vécu jeune homme avec celui où il promène sa vieillesse souriante n'est pas à notre honneur.
Nous avons laissé se perdre des biens précieux, dont le premier est la politesse. Nous sommes entrés dans un âge brutal et agité, dont l'extrême civilisation est une forme plus raffinée de la barbarie. C'est encore un avantage de cette littérature des Mémoires, qu'en nous remettant sous les yeux l'image des qualités qui furent les nôtres, elle nous en donne la nostalgie et peut-être nous inspirera le désir de les rappeler d'un exil qui a déjà trop dure.
René DOUMIC.
CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
CHAPITRE PREMIER
Le Piémont à la veille de la guerre d'Italie. La maison de Savoie et l'indépendance italienne. Le roi Charles-Albert à Novare. Victor-Emmanuel et Cavour. Le château de Moncalieri. La fille du tambour-major. Le prince Humbert, le duc d'Aoste et le colonel de Sonnaz. Le mot de la fin d'un gentilhomme. La princesse Clotilde. La campagne d'Italie. L'intervention de Napoléon III. L'armée française franchit les Alpes. Montebelo. Mort héroïque du baron de Blonay. Le général Maurice de
Sonnaz et la cavalerie piémontaise. Bataille de Magenta. Épisode dramatique. Le maréchal Baraguey d'Hilliers et son état-major. Rencontre du duc de Chartres. Bataille de Solferino. San Martino. Le général Mollard. Villafranca. Conditions de la paix. Le mouvement
annexioniste en Savoie. Sentiments personnels de Victor-Emmanuel. Séjour des princes à Chambéry. L'annexion est certaine.
Le 1er janvier 1859, Napoléon III, recevant le corps diplomatique, avait dit à l'ambassadeur d'Autriche : « Je regrette que nos relations avec votre gouvernement ne soient pas aussi bonnes
2--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
que par le passé. Je vous prie de dire à l'Empereur
que mes sentiments personnels pour lui ne sont pas changés. »
Apostrophe significative, à la suite de laquelle l'opinion européenne violemment surexcitée, en dépit des démentis officiels, fut portée à considérer la guerre comme inévitable.
En Piémont plus que partout ailleurs ce sentiment s'empara des esprits et bientôt l'agitation y fut à son comble. On croyait fort peu à un dénouement pacifique et l'on attendait les événements avec fermeté, mais en général sans grand enthousiasme. Car la cause de l'indépendance italienne, si invraisemblable que cela paraisse de nos jours, n'était alors chez les Piémontais rien moins qu'universellement en faveur
Les conservateurs, les Codini , comme on les appelait par allusion aux perruques à queue de l'ancien régime, ne s'y intéressaient nullement et manifestaient même à son égard une hostilité assez accentuée, en ce qu'ils la tenaient pour étroitement liée au mouvement révolutionnaire, et, de plus, pour un rêve chimérique impossible à réaliser.
Les moins réfractaires d'entre eux à l'idée d'une Italie libre estimaient qu'une guerre contre
3--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
l'Autriche était une entreprise trop dangereuse pour que l'Empereur des Français se décidât à s'y lancer. Jusqu'à la veille de l'ouverture des hostilités, ils doutèrent de l'intervention du souverain qui leur apparaissait comme la personnification des principes d'ordre et de conservation sociale, et ce scepticisme les affermissait dans leurs tendances antibelliqueuses.
Le peuple, de son côté, n'éprouvait que de l'indifférence.
Quant à l'armée, tout en désirant la guerre pour elle-même, ce qui est le propre des militaires, elle ne se passionnait pas non plus pour son but. Les officiers de tout grade, appartenant en très grande majorité à l'aristocratie, professaient une aversion profonde pour les Italiens en général et pour les Lombards en particulier. Ils ne pardonnaient pas à ces derniers d'avoir manqué, en 1848, au rendez-vous qu'ils avaient donné à Charles-Albert sur les bords de l'Adige, où, suivant sa promesse, ce roi magnanime et trop confiant avait refoulé les Autrichiens.
Si bien que le petit nombre de Milanais, de Toscans, de Napolitains et tutti quanti qui, s'étant fait naturaliser, avaient pris du service en Piémont, étaient assez mal vus de leurs camarades
4--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
et ne parvenaient que difficilement à vaincre une animosité dont il résultait de continuels froissements.
Il s'en rencontrait plus d'un pourtant, de ces transfuges, à qui il eût été injuste de contester un réel mérite et d'indiscutables aptitudes professionnelles.
Seuls les libéraux avancés et les politiciens militants de cette nuance songeaient aux destinées de l'Italie émancipée du joug de l'étranger.
Ceux-là se remuaient, intriguaient au Parlement ou conspiraient dans l'ombre, de connivence avec les grands agitateurs de la péninsule, déployant une prodigieuse activité et appuyant sans relâche la politique à longue portée, exclusivement italienne, poursuivie avec autant de persévérance que d'habileté par le roi Victor-
Emmanuel et son ministre Gavour. C'est donc, en réalité, à la maison de Savoie que l'Italie doit son indépendance. Qu'on se rappelle le temps où Victor-Emmanuel, au début de son règne, disait à sir James Hudson, ministre d'Angleterre à Turin : « Je ferai à l'Autriche la guerre au couteau » (the war to the knife).
Déjà Charles-Albert, qui échoua dans la vaste entreprise que son fils, avec l'aide de la France, put réaliser dans la suite, avait tout sacrifié,
5--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
même sa couronne, même sa vie, à l'indépendance italienne. On peut dire que ce fut la grande pensée de son règne. Et, sans vouloir rechercher la part d'influence que les sociétés secrètes, auxquelles on le disait affilié, ont pu exercer sur la ligne politique suivie parce prince, il est certain que, par ses antécédents, par son caractère chevaleresque, par la tournure de son esprit, il semblait prédestiné au rôle qu'il a joué dans l'histoire.
Singulière et imposante personnalité que celle de ce roi, grand par plus d'un côté, et que la fatalité avait marqué de son sceau! Nature étrange et captivante, faite d'élévation dans les sentiments, d'ampleur dans les conceptions et de petits scrupules, d'inébranlable fermeté et d'indécision, de mysticisme religieux et de romanesque profane, de ténacité dans le but et de tergiversations dans les moyens; supérieur, en somme, profondément pénétré de l'importance de sa mission et l'accomplissant jusqu'au bout, avec une abnégation sans égale, avec un rare mérite, mais aussi avec une sombre mélancolie, une sorte de désespérance, qui était un des traits saillants de sa personnalité et que trahissait, du reste, sa physionomie.
6--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Un instant, la fortune parut lui sourire ; à la tête de sa vaillante petite armée, il eut d'abord des succès presque inespérés. Puis il fallut céder devant le nombre.
Le soir de la bataille de Novare, il éprouva une telle angoisse à mettre son épée au fourreau qu'il voulut mourir avec son pays.
« Ceux qui l'ont vu en ce moment et n'en sont pas morts, a écrit Ignotus dans ses Portraits , vous diront que le Roi, père de Victor-Emmanuel, s'avança dans un espace resserré entre un mur et une haie. On entendait, dans la campagne, comme un râle immense. « Le cheval du Roi se cabra. Il n'y avait aucune émotion sur la figure du vieux Roi. Figure osseuse, grande et sévère, Charles-Albert voulait être tué, voilà tout. Et il attendait les boulets. Ses aides de camp tombaient, il attendait toujours. Enfin il comprit que la mort ne voulait pas de lui. Il quitta lentement le champ de bataille, retenant son cheval épouvanté, comme pour laisser à la mort le temps de changer d'avis... »
On sait le reste. Quelques heures après, l'illustre vaincu abdiquait en faveur de son fils. « Je ne suis plus votre Roi, disait-il à son entourage ému et consterné. Le voilà, votre Roi, c'est mon fils
7--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Victor. » Puis il embrassait chacun et, se retirant dans la chambre voisine avec ses deux fils, il partait pour Oporto, où bientôt il devait succomber en véritable martyr.
Il était réservé à son successeur immédiat, à Victor-Emmanuel, de continuer et de parachever glorieusement son uvre. J'ai servi, approché, aimé ce prince et je crois pouvoir en parler sans paraître trop osé.
Le jour où pour la première fois il m'a été donné de le voir, trois ans après celui où il avait ramassé sur le champ de bataille la couronne brisée de son père, il était en grand uniforme, fièrement campé sur un superbe demi-sang, ce qui rehaussait à miracle sa physionomie plus martiale et expressive, à vrai dire, que distinguée.
Et pendant qu'il passait devant moi, aux acclamations de la foule, dans un nuage de poussière doré par les rayons d'un soleil couchant, j'eus comme une vision du passé : je me le représentai le soir de la bataille de Novare, arrivant tout ensanglanté, tête nue, l'uniforme déchiré, les bottes poudreuses, devant le maréchal Radetzki, qui, en l'apercevant, se découvrit et dit : « Sire, c'est au vieux soldat de l'Autriche de se découvrir devant le roi de Sardaigne.»
8--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Le rapprochement de ce dramatique épisode avec le tableau qui s'offrait à ma vue frappa vivement mon imagination et, malgré mon jeune âge, me fit une profonde impression. Plus tard, à cette première impression sont venues s'en ajouter d'autres, plus précises, plus raisonnées, au fur et à mesure que j'ai pu connaître et apprécier le futur roi d'Italie, et j'en ai tiré des conclusions qui ne concordent nullement avec les opinions généralement répandues.
Pour le public, dans sa très grande majorité, Victor-Emmanuel, en effet, ne fut jamais qu'un incomparable soldat, un brillant et légendaire sabreur, se désintéressant de la politique et en laissant le soin au grand homme qui passe aux yeux de beaucoup de gens pour avoir édifié à lui seul l'unité de l'Italie. Or, rien n'est plus erroné. Soldat, il l'était à coup sûr, comme tous ceux de sa race; mais il n'était pas que cela. Il avait une autre envergure et bien d'autres cordes à son arc.
Il était au premier chef un profond politique doublé d'un habile diplomate, cachant sous les dehors d'une insouciante bonhomie et d'une rudesse toute militaire une remarquable perspicacité et une subtilité d'esprit à déconcerter les plus
9--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
avertis. Affectant, par calcul et pour donner le change, de se confiner dans le rôle effacé de souverain constitutionnel, il n'en donnait pas moins l'impulsion à la machine gouvernementale, pour toutes les affaires de quelque importance, voyant tout, sachant tout, prévoyant tout, inspirant le plus souvent ses ministres et agissant même en dehors d'eux. « C'est le plus fort de nous tous », ne manquait jamais de dire M. de Gavour, lorsqu'il en trouvait l'occasion.
J'ajoute qu'indépendamment des qualités primordiales que je viens de signaler, il en avait une d'ordre plus intime, mais aussi précieuse et aussi rare : c'était un grand fonds de bonté, voire de sensibilité, qui se manifestait en toutes circonstances, sous toutes les formes, et contribuait dans une large mesure à son immense popularité.
Le défaut de sa cuirasse, en tant que chef d'État, résidait dans la profonde et insurmontable aversion que lui inspiraient la représentation et les exigences protocolaires, auxquelles il ne se soumettait qu'à contre-cur et lorsque décidément il n'y avait plus moyen de s'y soustraire. Ce qui n'excluait, du reste, ni la générosité la plus noble ni même une déplorable prodigalité,
10--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
explicable seulement à quoi bon le dissimuler? par le dérèglement et les défaillances de sa vie privée.
Sa cour était, à Turin, d'une simplicité antique et se bornait à une maison militaire des plus modestes.
Encore n'avait-il sans cesse d'autre préoccupation que de s'en éloigner, en multipliant les déplacements. Sobre, ne faisant qu'un repas par jour, il préférait les mets simples; et, quand il était contraint d'assister à un dîner à la cour, il ne touchait à aucun plat, ne dépliant même pas sa serviette. Les mains appuyées sur le pommeau de son sabre, il promenait sur les convives un regard scrutateur, sans dissimuler son impatience et son ennui.
Il aimait passionnément les chevaux, la chasse et les exercices du corps. Constamment il lui arrivait de partir seul, avec deux aides de camp, pour chasser le chamois ou le bouquetin dans les montagnes. Là, vêtu d'une simple vareuse, il courait à travers les rochers, couchant à la belle étoile, mangeant dans des chaumières ce qu'il y trouvait, et il rentrait dispos et alerte, tandis que ses infortunés officiers arrivaient exténués.
J'allais oublier de constater que le roi galant'-uoma
11---CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
................................................................................
.....................................................
179 CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Je le trouvai de fort bonne humeur et on ne plus satisfait de l'accueil qu'on lui avait réservé.
Mais, sans s'appesantir sur ce sujet, il me demanda à brûle-pourpoint pourquoi je n'étais pas allé l'attendre à la gare, où il prétendit aimablement avoir remarqué avec peine mon absence.
J'eus beau lui expliquer qu'à Paris j'étais redevenu un simple particulier, n'ayant aucun titre à figurer dans une cérémonie officielle, il ne voulut rien entendre et se récria sur ce que, au lieu de lui envoyer ses amis, on lui avait dépêché une foule de gens qu'il ne connaissait pas et qui lui étaient parfaitement indifférents.
Puis, il me consulta sur la question de savoir s'il pouvait, comme il en avait le désir, faire une visite à M. Thiers. A quoi je répondis que je n'en voyais point la nécessité, mais qu'il ne me semblait pas qu'il pût y avoir à cela de graves inconvénients, Il me parut enchanté de ma réponse et je ne doutai pas, en le quittant, qu'il n'exécutât son projet.
Mais il arriva que le jour suivant, M. Prosper Bourée, ancien ambassadeur à Constantinople, qui avait représenté la France à Téhéran bien des années avant moi, vint à son tour présenter ses hommages à Sa Majesté Persane. Interrogé comme
180--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
je l'avais été la veille sur l'opportunité d'une démarche courtoise auprès de l'ex-président, M. Bourée, qui ne pouvait pas souffrir M. Thiers, répliqua froidement en ces termes : Je n'ai pas de conseils à donner à Votre Majesté. Seulement je dois lui faire observer que
M. Thiers est le chef des Babys français. Or, les Babys sont des révolutionnaires redoutables qui, ayant attenté plus d'une fois aux jours de Nasser-Eddin, lui inspiraient une horreur profonde et devaient, au reste, vingt ans plus tard, finir par l'assassiner...
M. Thiers ne reçut pas la visite du Shah de Perse! Quoi qu'on en ait dit, Nasser-Eddin Shah se comporta, en somme, très correctement pendant le séjour qu'il fit à cette époque parmi nous. Il sema l'or à pleines mains, se laissa congrûment exploiter et n'eut pas trop l'air de s'apercevoir des convoitises qu'excitait dans les rangs de ces demoiselles du Bois sa légendaire aigrette en diamants.
Seuls les salons, où la promiscuité des sexes et la vue des corsages décolletés renversaient toutes ses idées, lui inspirèrent par-ci par-là quelques sorties étonnantes qui ne manquaient pas de
181--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
.............................................................................
XVI--- CHAPITRE
Une phalange d'académiciens. Le salon littéraire de Mme de Loynes. Dîners académiques. Convives de fondation. Ernest Renan. Anatole France. Henri Houssaye. Jules Lemaitre. Maurice Barrés. Albert Vandal. L'assassinat du Shah de Perse prédit.
Étrange réalisation de cette prédiction. Un centre mondain de politique militante. Un salon à tout jamais fermé par la mort de celle qui en était l'âme et le charme.
Au moment de clore ce journal, ma pensée se reporte à un épisode de ma vie qui ne compte pas parmi les moins intéressants et dont le souvenir m'est trop agréable pour que je me résigne à le passer sous silence. Il s'agit de l'époque encore rapprochée de nous où ma bonne étoile me mit assez fréquemment en contact avec des immortels. Ce fut un salon
ami, celui de Mme de Loynes, alors exclusivement littéraire, qui m'en fournit l'occasion. J'y rencontrai périodiquement toute une phalange d'académiciens et non dis moins réputés
295---CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
qui s'empressaient autour de la plus séduisante des maîtresses de maison et dînaient chez elle à tour de rôle une fois par semaine.
Ernest Renan, Anatole France, Henri Houssaye, Jules Lemaître, Maurice Barrés, Albert Vandal, Ernest Daudet, Hébrard, Francis Magnard, Blowitz, et deux ou trois autres occasionnellement étaient les convives accoutumés de ces dîners triés sur le volet. Les habitués y assistaient avec d'autant plus de ponctualité et de plaisir qu'ils y étaient entre confrères et qu'ils s'y sentaient à l'aise, grâce surtout à l'affabilité enveloppante, à la bienveillance communicative et à l'habileté rare de leur charmante hôtesse.
Elle avait un talent prodigieux pour maintenir la bonne harmonie dans son entourage, éviter les froissements, panser, au besoin, les blessures d'amour-propre et amener, sans avoir l'air d'y toucher, chacun de ses amis à déployer toutes les ressources de son esprit et de son savoir. Elle s'y entendait comme personne à prodiguer individuellement
les flatteries délicates et les témoignages indirects de sympathie, qu'elle distribuait avec tant de naturel, de tact et de mesure que tous s'en allaient « persuadés de son estime et de son amitié, sans qu'ils se pussent dire à eux
296---CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
mêmes quelle marque elle leur avait donnée de l'une et de l'autre » . Et ce n'était point chose banale que la réunion de ces personnages de premier plan, avec chacun son tour d'esprit, sa marotte, sa manière de s'exprimer et ses affinités littéraires ou autres.
Qui le croirait? Renan, tout en dégustant avec componction des truffes et du pâté de foie gras, se livrait de préférence à des dissertations quintessenciées sur l'amour, qui, dans la bouche de cet ex-ecclésiastique, gros, gras, onctueux et somnolent, étaient d'un comique et d'un ridicule achevés. La plupart du temps, il se bornait à ruminer lourdement dans un fauteuil, où il don nait plutôt l'impression d'un vieux sybarite, désenchanté et fatigué, que celle d'un philosophe féru de métaphysique et d'un littérateur maniant la langue française avec une souplesse et une maîtrise qu'aucun de ses contemporains n'a surpassées.
Il n'avait pas complètement dépouillé le séminariste d'antan, ce qui faisait dire à l'un de ses confrères les plus spirituels : « Renan, c'est une cathédrale désaffectée. » Anatole France, un peu sec, correct, disert, très dix-huitième siècle, dépensait beaucoup d'esprit et d'éloquence à soutenir, avec une modération
297--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
voulue, les thèses les plus variées. Nul doute qu'il ne fût athée, cela perçait à chaque instant sans qu'il eût besoin de l'affirmer; mais son irréligion n'avait rien d'absolu, d'agressif ni de canaille. C'était l'état d'âme d'un intellectuel qui voudrait être convaincu par des preuves, non l'irritante outrecuidance d'un bourgeois à courtes vues qui croit se rehausser en faisant l'esprit fort. Très différent de ce dilettante de marque, le bon Henri Houssaye, sans briller au même degré dans la conversation, avait toutes les qualités de
l'homme au cur bien placé, au jugement sain, au caractère loyal et foncièrement honnête qu'il était. Concentré, réservé, taciturne, sentimental aussi, il parlait rarement et sobrement, pour définir une situation ou pour émettre un avis, marqué au coin du bon sens et de l'équité. Travailleur infatigable et consciencieux, il paraissait fait pour l'étude bien plus que pour le monde, où, pourtant, on l'aimait et le choyait, non seulement pour son mérite, mais pour son attrait personnel.
Son ami, le charmant et impressionnable Jules Lemaître, qui n'avait pas encore trouvé son chemin de Damas, se plaisait à conter des anecdotes, parfois d'une orthodoxie douteuse, ne
298--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
manquant ni d'intérêt ni de finesse, mais qu'il eût certainement mieux écrites qu'il ne les disait. Écrivain de race, nature raffinée et sensible, il captivait par sa sincérité et par une simplicité de bon aloi, qu'accentuaient une politesse et une aménité comme on en rencontre rarement. Rien, d'ailleurs, n'indiquait que de cet homme de lettres par excellence on dût faire un jour un politicien... Maurice Barrés, au contraire, menait déjà de front la littérature et la politique. C'est même par celle-ci que, grâce au boulangisme et à une circonstance particulière, il avait commencé.
Froid, étrange, énigmatique, d'une mentalité toute personnelle, que son langage et son allure révélaient de prime abord, il intéressait surtout par des aperçus presque toujours inattendus et par sa manière d'articuler les choses les plus comiques d'une voix grave, sans se départir un instant de son imperturbable sérieux. Jusqu'à l'accent lorrain, qu'il avait assez prononcé, tout en lui était curieux, piquant, étonnant et merveilleusement propre à solliciter l'attention. Aussi jouissait-il du privilège d'être toujours écouté. Quant à Albert Vandal, on ne saurait mieux le définir qu'en disant qu'il était homme du monde
299---CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
aussi accompli qu'éminent historien et remarquable écrivain. Habituellement réservé, par tempérament et par l'excès d'une modestie égale à son talent, il charmait, lorsqu'il se décidait à s'écarter de sa retenue ordinaire, par l'étendue et la variété de ses connaissances autant que par le tour ingénieux qu'il savait donner à l'expression de sa pensée. Il va de soi que, dans ce cénacle de beaux esprits où je me considérais un peu comme un intrus, il m'arrivait plus souvent d'écouler que de parler. Un soir cependant, le hasard fit que j'eus, bien malgré moi, longuement à discourir.
C'est qu'il était question de la Perse, que Blowilz, le correspondant du Times, je ne sais plus à quel propos, venait de mettre sur le tapis et qu'alors, comme toujours en pareil cas, je lus aimablement invité à faire la petite conférence qui m'a été infligée une trentaine de fois dans mon existence.
Je développai mon sujet, que je ne possédais que trop; et comme j'en étais à la secte révolutionnaire des Babys , je dis qu'ils avaient attenté plusieurs fois à la vie du Shah régnant, Nasser- Eddine, et que je ne serais pas surpris que ce monarque succombât, un jour ou l'autre, à une nouvelle tentative de ces fanatiques irréconciliables ...
300--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
Il était près de minuit. Chacun rentra chez soi, sans se préoccuper, je suppose, plus que de raison de Nasser-Eddine et des Babys. Mais, le lendemain matin, tous les journaux annonçaient... que le Shah de Perse avait été assassiné par un Baby et était mort sur le coup ! Stupéfaction de mes auditeurs de la veille.
D'aucuns me la manifestèrent par écrit, avec des commentaires fort spirituels. Ernest Daudet, qui était des nôtres au dîner où j'avais prophétisé, sans me douter que ma prophétie était un fait accompli depuis plusieurs heures, Ernest Daudet fit plus : il publia, je ne sais plus dans quel journal, un très joli article racontant l'histoire parle menu et soulignant l'originalité de la coïncidence vraiment extraordinaire, qu'il avait eu, avec quelques autres, occasion de-constater.
Ce petit incident fut l'épilogue du cycle de mes agapes, oserai-je dire, académiques. Le salon de Mme de Loynes était devenu un centre de politique militante dont j'avais toutes sortes de bonnes raisons de me tenir éloigné. Je n'y allai plus qu'en visite et autant que possible en dehors des heures où les attentifs affluaient. Mais je ne cessai d'en franchir le seuil qu'après avoir conduit au cimetière celle qui en était l'âme et le charme.
CONCLUSION
Ici s'arrêtent mes souvenirs. Le demi-siècle qu'ils embrassent fut à ce point fécond en grands événements, en découvertes sensationnelles, en
transformations de toute .sorte que si, jetant un regard en arrière, on s'avise de mesurer le chemin parcouru, on croit avoir fait un songe. De la
guerre d'Italie à nos jours, on peut le dire sans exagération, la face du monde a changé. Ces cinquante années ont vu se transfigurer, mourir et
surtout naître tant de choses qu'il semble que normalement et du train dont allaient nos pères, deux ou trois siècles n'y eussent pas suffi.
Qu'on se figure un homme mort depuis quinze ou seize ans au plus, tout à coup ressuscitant et surgissant avec la mentalité de son temps, au
milieu de nous : quels ne seraient pas son trouble et sa stupéfaction? L'éclairage électrique dans ses applications nouvelles, la traction mécanique vulgarisée et multipliée à l'infini, le téléphone, la
302--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
télégraphie sans fil, les ballons dirigeables, les aéroplanes et leurs incroyables prouesses, pour ne citer que ce qui saute aux yeux, tout cela, sans parler de nos murs et des soubresauts de la politique internationale, lui paraîtrait invraisemblable, fantasmagorique, affolant, alors que nous autres nous n'y prêtons plus qu'une attention distraite, habitués que nous y sommes jusqu'à ne presque pas concevoir l'existence sans des accessoires qui insensiblement sont devenus pour nous des nécessités.
En sommes-nous plus heureux? Avons-nous par cela même conquis sur nos devanciers une écrasante supériorité? Le temps présent nous a-t-il réellement apporté le progrès dans une mesure aussi large, aussi complète qu'un grand nombre d'entre nous l'imaginent?... Oui et non,
suivant l'aspect sous lequel on envisage la question.
Indiscutablement l'uvre scientifique accomplie dans les temps modernes est prodigieuse, immense et mérite d'être glorifiée. Reste à savoir si parallèlement et dans les autres branches non moins importantes de l'activité humaine, nous nous sommes améliorés et perfectionnés en proportion. Sous le rapport de la morale publique, du caractère, de la virilité, de l'ordre social et
303--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
politique, et accessoirement du savoir-vivre et des bonnes manières, avons-nous progressé? Assurément non.
Nous en sommes arrivés à fouler aux pieds tous les principes, à renverser toutes les barrières, à supprimer tous les devoirs, pour y substituer la seule préoccupation de l'intérêt personnel; l'incohérence et la fantaisie nous tiennent lieu de règle et l'outrecuidance de discipline. « Nous sommes devenus de francs démocrates, que les véritables supériorités épouvantent, que les grandes distinctions sociales révoltent, que la dignité du cur, la pureté du langage offensent, auxquels l'élégance des manières fait horreur.
Nous sommes des égalitaires qui ont en haine toutes les couronnes : couronnes de roi, couronnes de marquis, couronnes de laurier, couronnes de lierre, auréoles de pureté Nous détestons toutes les noblesses; un homme distingué nous est suspect, une incontestable supériorité nous est insupportable. » Mais, comme l'égalité absolue est hors nature, comme elle ne peut, malgré tout, exister qu'au cimetière, il nous a fallu subir l'inégalité de fortune, que rien ne saurait supprimer, et nous avons inauguré le règne de la ploutocratie, de l'omnipotence de
304--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
l'argent, c'est-à-dire institué la plus immorale et la plus tyrannique des aristocraties. Phénomène paradoxal, qui n'est pas la moindre des surprises que nous réservait la singulière, intéressante et déconcertante époque où nous vivons. La chasse aux richesses, qui devait fatalement résulter d'un tel désordre social, a considérablement élargi le champ intermédiaire entre la
stricte honnêteté et la filouterie légale ; le nombre des déclassés et, par conséquent, des anarchistes s'est accru du même coup dans d'énormes proportions; les marchandages électoraux et les turpitudes parlementaires ont fait le reste. De plus, la rapidité des fortunes, la vulgarité des murs, la promptitude de l'élévation et de l'abaissement des personnages modernes ont influé sur nos idées et ôté à nos sentiments une partie de leur noblesse. Nous perdons peu à peu la notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la supériorité du droit chemin sur les expédients.
Nous nous accoutumons à ne priser que le succès, à ne croire qu'à la chance et à l'intrigue, à dédaigner l'effort et le mérite. Si bien, qu'à moins d'une forte secousse, d'un vigoureux retour sur nous-mêmes, nous risquons de glisser sur la pente d'une décadence aboutissant tôt au tard à la
305--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
décomposition. L'histoire offre plus d'un exemple du sort réservé aux grandes nations qui s'abandonnent. Les hommes de ma génération ont eu la malchance de vivre à une époque de transition entre ce qui n'existe plus et ce qui n'existe pas encore, sans que leur éducation les eût congrûment préparés à affronter des difficultés pour lesquelles ils étaient insuffisamment armés. Leur malheur a été « d'être placés entre une vieille société qui s'en va, qui n'a plus qu'un semblant de vitalité, qui ne vit nue de préjugés et de contradictions, et une société nouvelle apparaissant à l'horizon, mais n'étant encore ni constituée ni même clairement définie. La lutte incessante entre le moribond qui se cramponne à l'existence et le nouveau-né qui cherche à grandir et réclame la meilleure place au soleil, cette lutte produit le tumulte, le chaos, les ténèbres au milieu desquels nous nous agitons » et paralyse les efforts des clairvoyants et des énergiques qui, sachant s'adapter aux circonstances, ont la noble ambition de concourir utilement à l'uvre de salut qu'il s'agit d'entreprendre et de mener à bien.
Nos successeurs seront plus heureux. Nés et élevés dans une atmosphère nouvelle, sans
306--- CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS
attaches avec le passé, sans idées préconçues, dûment avertis du but à poursuivre et des conditions dans lesquelles devra s'exercer leur initiative, ils pourront se mouvoir et agir avec plus de liberté et d'efficacité qu'il ne nous a été permis de le faire. En tout cas, s'ils ne remplissaient pas tout leur mérite, s'ils faisaient fausse route ou désertaient le champ de bataille, ils n'auraient pas la même excuse que nous. (Fin)